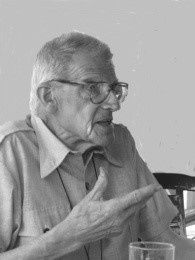|
Eloge de la prise de risque en christianisme - 7 |
| Jacques Musset |
7° La prise de risque des chrétiens de base dans la crise actuelle de l'Eglise romaineSouvent les chrétiens catholiques de base se sentent impuissants face au visage institutionnel que leur donne leur Eglise, repliée sur ses dogmes, ses langages figés, sa morale et son organisation hiérarchique qui détient le pouvoir absolu. Ils ont le sentiment de se heurter à du béton. Un certain nombre s'en sont retirés sur la pointe des pieds sans abandonner pour autant de porter intérêt à Jésus, et le mouvement se poursuit. D'autres continuent à travailler de l'intérieur à sa rénovation sans se faire trop d'illusion sur sa mutation nécessaire. D'autres encore sans lien avec l'Eglise hiérarchique ou en conservant avec elle des liens ténus s'efforcent au nom de leur passion pour l'Evangile de l'actualiser dans leur vie personnelle et dans leur existence sociale. Ils estiment qu'ils sont autant l'Eglise que le pape, les évêques et les prêtres ainsi que les fidèles – de moins en moins nombreux, il est vrai -, qui les suivent sans se questionner. Comment s'y prennent-ils ces chrétiens de base pour demeurer disciples de Jésus sans se complexer ni se culpabiliser de prendre des chemins de traverse ? Quand les échafaudages ( le système catholique) sur lesquels ils s'appuyaient auparavant se révèlent déficients par rapport à leurs attentes, il leur faut se prendre en charge, persuadés qu'au coeur de leur Tradition, encombrée de tas de revêtements inutiles et insignifiants, empilés au cours des siècles, il s'agit de rejoindre la Source qu'est Jésus de Nazareth pour s'en nourrir et en vivre. 1° Travailler les textes évangéliquesLes uns se mettent seul ou à plusieurs à travailler les textes évangéliques pour retrouver la figure historique du nazaréen qui a été occultée par des qualificatifs glorieux et divins qui lui ont été données dès les premiers siècles par la doctrine officielle : Fils unique de Dieu né du Père avant tous les siècles, seconde personne de la Sainte Trinité, sauveur et rédempteur de l'humanité pécheresse, souverain prêtre, etc.. Mais les évangiles eux-mêmes doivent être décodés car ils ne sont pas des reportages en direct sur Jésus, mais les expressions diverses de la foi des premiers chrétiens sur Jésus exprimées dans des langages et des formes littéraires dont le sens n'a rien d'évident pour les hommes et femmes modernes. La preuve, c'est que des pans entiers des évangiles, lus d'une manière littérale, peuvent à bon droit les intriguer spontanément voire leur paraître invraisemblables ( les récits de l'enfance de Jésus, les récits de miracles, ceux des apparitions de Jésus ressuscité qui défient les lois de la nature...). Des ouvrages sérieux, vulgarisant les travaux de l'exégèse ( étude des textes) depuis plus de deux siècles ne manquent pas. Ils permettent de s'approprier pas à pas le Jésus historique à travers les professions de fois évangéliques des premières communautés chrétiennes. Ils donnent des clés indispensables pour percevoir à travers ces relectures croyantes de l'événement Jésus non pas une biographie du nazaréen ( c'est impossible) mais ce qui a été sa vie, son enseignement et sa pratique libératrice, les enjeux sur lesquels il a engagé courageusement son existence au nom de son Dieu, les conflits qu'il a suscités et qui ont entraîné son élimination(1). Le visage du galiléen qui affleure alors est celui d'un homme libre, soucieux d'authenticité, refusant modes et compromissions, profondément intériorisé, habité par la parole vive et tranchée des prophètes, défendant bec et ongles l'honneur de son Dieu sali par le légalisme et le ritualisme, l'hypocrisie et le mensonge, la peur et l'égoïsme, autant de sources d'oppression, de mépris, de rejet vis à vis d'hommes et de femmes marginalisés à cause de leur conduite, de leur maladie, de leur pauvreté, de leur métier, de leur statut social et religieux... Ce Jésus-là a de quoi inspirer et dynamiser aujourd'hui celles et ceux qui sont lassés des propos convenus, pieux et aseptisés. 2° Travailler sur l'histoire du christianismeD'autres également seuls ou en groupe, conscients de l'immense fossé entre ce que fut Jésus et ce qu'on a fait de lui depuis 20 siècles, veulent comprendre comment on en est arrivé là. Ils se livrent à un travail historique leur permettant de prendre conscience de la relativité de la doctrine et de l'organisation catholique actuelle qui prétendent exprimer la Vérité sur Jésus et sur son Dieu. Cette doctrine et cette organisation sont en effet le fruit de maintes élaborations qui ont commencé dès la disparition de Jésus et qui se sont poursuivies au cours des siècles, chacune essayant dans son contexte culturel de donner sens à l'événement Jésus. En voici une très rapide évocation. Dès le départ, les premiers chrétiens ont présenté Jésus en fonction de leur culture religieuse juive, de leurs attentes spirituelle, de leurs problèmes communautaires. Cela a donné les textes du Nouveau Testament, dont les évangiles. On n'y atteint pas Jésus en direct mais un Jésus toujours situé, celui de la foi de disciples. Il y a autant de visages de Jésus qu'il y a de textes. Chaque évangile est une interprétation originale de Jésus. A partir de là, le christianisme s'établissant dans des régions de culture grecque, les chrétiens de ces contrées ont interprété les textes du Nouveau Testament à travers le prisme de leurs représentations (l'homme est une âme et un corps) et à travers leurs concepts (par ex. ceux de personne, de nature et de substance qui n'ont pas le sens que nous prêtons aujourd'hui à ces mots). Il en est résulté des dogmes définis lors des premiers conciles aux IVème et Vème siècles, considérés comme Vérité divine et s'imposant à tous les chrétiens, y compris par la force. De là datent les affirmations grandioses sur l'identité de Jésus, Dieu et homme, sur Dieu Trinité, sur le Saint Esprit, 3ème personne de la Sainte Trinité. Ce socle dogmatique étant posé, malgré bien des dissensions entre évêques, les siècles suivants jusqu'à nos jours l'ont répété et développé(2). On en a déduit de nombreuses considérations sur L'Eglise, les sacrements, les ministères en en attribuant indûment la paternité à Jésus et en les référant à une volonté divine. Ainsi, les ministères actuels que sont l'épiscopat, le sacerdoce ont été mis en place dans les premiers siècles. Les sept sacrements sont apparus au XIIIème siècle.L'infaillibilité du pape a été définie au XIXème siècle. On peut multiplier les exemples en lisant le Catéchisme de l'Eglise Catholique promulgué par Jean-Paul II en 1992. La doctrine qui y est présentée et déclarée normative est le résultat de ces élaborations successives qui se sont ajoutées et surajoutées les unes aux autres et qui ont été sacralisées alors qu'elles n'étaient que des expressions relatives de l'événement Jésus dans un contexte particulier qui n'est plus le nôtre(3). 3° Qui est Jésus de Nazareth ?De ce travail découle la nécessité de revenir à la source du christianisme qu'est Jésus de Nazareth, dont le mouvement de l'existence est si éloigné de la doctrine catholique actuelle. C'est un nouveau chantier qui s'ouvre. Qui était Jésus de Nazareth, quels furent ses engagements, sur quoi a t-il misé sa vie, à quel Dieu se référait-il ? Résumons ses convictions et sa pratique qui se situent dans la ligne des prophètes qu'il a affinée, approfondie, universalisée. Pour lui, le vrai culte rendu à Dieu ce n'est pas le simple respect scrupuleux des prescriptions légales ni l'accomplissement des rites formels, c'est d'abord la relation juste avec autrui, notamment celui qui est marginalisé, oublié, rejeté, laissé pour compte, c'est la recherche d'authenticité dans ses propres intentions et actions, c'est le souci de cohérence entre son dire et son faire. Prière, recueillement et rite sont au service de cette manière de vivre(4). Ainsi le Dieu de Jésus n'est pas un Dieu religieux, son lieu est avant tout « le plus humain de l'homme », selon la belle expression de Maurice Bellet. En proclamant quelque temps après la mort de Jésus que Dieu l'avait ressuscité, ses apôtres affirmaient que leur maître loin d'être le fossoyeur de la religion était le témoin exemplaire du Dieu invisible et innommable et que son témoignage était chemin de la vraie vie pour quiconque s'en inspirerait. 4° Comment actualiser l'esprit de Jésus aujourd'hui ?Mais la question rebondit : s'il faut revenir à la Source qu'est Jésus, comment actualiser son enseignement et sa pratique dans notre contexte actuel de sorte que cette actualisation soit crédible pour nos contemporains en recherche de sens ? C'est encore l'enjeu d'une réflexion de fond. Il ne s'agit pas en effet de reproduire tel quel ce qu'a vécu Jésus. Les disciples de Jésus ne vivent pas dans le même monde ni dans la même culture ni avec les mêmes représentations que lui. Il s'agit pour eux de s'inspirer de l'esprit qui l'animait en profondeur et de le traduire, personnellement et socialement, d'une manière créative et inédite dans le monde qui est le leur, en paroles et en actes, y compris dans leur manière de célébrer. Cette démarche exigeante qui ne se contente pas de répéter mais d'inventer est une prise de risque dont ils ne peuvent pas se dédouaner sans se trahir. C'est la responsabilité des disciples de Jésus et de chacun d'eux là où il vit, même s'ils doivent se souvenir que Jésus n'appartient à personne. Hors communauté chrétienne, des hommes et des femmes de toutes croyances ou sans croyances religieuses s'inspirent et s'inspireront toujours, consciemment ou non, des valeurs qu'ils a promues et qui correspondent aux valeurs humaines les plus fondamentales. Celles de notre monde occidental sécularisé ne sont-elles pas pour une part d'origine judéo-chrétienne ?(5) 5° Comment parler du Dieu de Jésus aujourd'hui ?Une autre interrogation surgit encore dans la tête et la conscience de ceux qui se réclament de Jésus. Comment parler aujourd'hui du Dieu dont il se réclamait ? Dieu est un mot usé, qu'on a mis à toutes les sauces, récupéré en tous sens, et dont les définitions du catéchisme que bien des gens ont encore en tête jouent un rôle de repoussoir. Pour Jésus, son Dieu était la Source intime de ses exigences intérieures qu'il traduisait en engagements pour la cause de l'homme. Pas plus que Jésus, ses disciples d'aujourd'hui comme d'hier n'ont accès directement à ce Dieu qui nous inspire au plus intime de nous-mêmes sans nous déresponsabiliser. Comment témoigner de Lui en notre temps(6) ? C'est une question fondamentale que les disciples de Jésus en recherche ne peuvent éviter. La réponse, n'est-ce pas de s'impliquer à sa manière dans la promotion de l'humain le plus humain en soi-même et au bénéfice des autres dans le cadre de son existence quotidienne ? A travers l'expérience du don, du dépassement de son ego, du refus des préjugés, de l'ouverture de soi aux autres, qui se traduisent par des choix et des engagements positifs, n'est-ce pas là le lieu où il est possible de reconnaître en soi une mystérieuse Présence inspirante ? Cette reconnaissance ne s'impose à personne. Elle est de l'ordre de la foi . En tout cas elle n'est jamais détachable pour les chrétiens d'une expérience d'humanité vécue dans l'authenticité. Cette expérience leur est commune avec tous les humains qui s'efforcent de vivre en vérité. Là se joue pour tous, croyants ou non, la valeur de leur propre existence. 6° Conclusion.Telles sont aujourd'hui pour ceux qui se prétendent disciples de Jésus quelques exigences nées de leurs questionnements d'hommes et de femmes modernes en vue de s'approprier personnellement le souvenir vivant de Jésus et de le traduire dans leur propre existence en toutes ses dimensions. Ces exigences sont interdépendantes et se renvoient l'une à l'autre nécessairement. Dans la pratique, les parcours peuvent être différents, mais chemin faisant ils renvoient aux interrogations fondamentales. L'enjeu en tout cela est de devenir des chrétiens libres et responsables, capables de rendre compte de leur foi d'une manière crédible et d'abord à leurs propre yeux, le reste étant donné par surcroît. Vue utopique ? Non, ces démarches sont déjà vécues avec ou sans pignon sur rue. Par ailleurs ceux qui y sont engagés n'ont pas la prétention de vivre l'aventure évangélique dans sa pureté et son intégralité ( c'est de toute façon irréalisable) ; ils font leur la phrase du poète René Char : « L'impossible nous ne t'atteignons pas, mais il nous sert de lanterne ». |
|
Jacques Musset |
| (1) Jésus de Nazareth, Jacques Schlosser, Noésis, 1999 ; Sauver la Bible du fondamentalisme, John Shelby Spong, Karthala, 2016 ; La résurrection, mythe ou réalité ? John Shelby Spong, 2016 (retour) (2) Sommes-nous sortis de la crise du modernisme ? Enquête sur le XXème siècle catholique et l'après-concile Vatican II, Jacques Musset, Kathala, 2016 (retour) (3) L'Eglise, Hans Küng, DDB, 1968 (retour) (4) Jésus, Hans Küng, Seuil, 2014 ; Jésus, approche historique, José Antonio Pagola, Cerf, 2013 (retour) (5) Jésus pour le XXIème siècle, John Shelby Spong, Karthala, 2013 ; (retour) (6) L'ultime secret, Gérard Bessière (158, La Grave, 46140, La Grave) ; Repenser Dieu dans un monde sécularisé, Jacques Musset, Karthala, 2015 (retour) |
commenter cet article …

/image%2F1442481%2F20150125%2Fob_077213_bateau-lpc.png)